Expériences de la nature : thème de français en CPGE scientifique 2025 - 2026
Oeuvres et présentation du thème de CPGE : Expériences de la nature

cours particuliers
Cours particuliers de français
Thème « Expériences de la nature » de français philosophie pour 2025-2026 de prépa
Pour l’année 2025 et 2026, le thème au programme des classes préparatoires scientifiques sera « Expériences de la nature« . Les élèves de maths sup qu’ils soient en MPSI, en PCSI, en MP2I, PTSI, BCPST et de maths spé (MP, PC, MPI, PSI, PT, BCPST2) devront donc étudier et plancher aux concours en deuxième sur ce thème et les œuvres choisies de Georges Canguilhem, Jules Verne et Marlen Haushofer.
Si vous souhaitez aller plus loin que les contenus gratuits, nous vous proposons de vous mettre en relation avec un professeur particulier de français ayant étudié le thème de cette année. Celui-ci pourra vous aider sur les aspects méthodologie, la connaissance du thème et des œuvres.
Groupe Réussite a sorti sur Amazon un livre sur le thème Expériences de la nature, rédigé par un normalien spécialiste des CPGE scientifiques. En parallèle, nous vous proposerons régulièrement sur le site des contenus totalement gratuits, avec notamment des analyses des œuvres, des citations commentées, des dissertations corrigées afin de vous aider à préparer et réussir les épreuves de français au concours.
Œuvres au programme de français en CPGE en 2025-2026
Voici les œuvres au programme de français philosophie sur le thème expériences de la nature en prépa scientifique :
- La Connaissance de la vie, « introduction : la pensée et le vivant, » « I, méthode », « III philosophie »- chapitres 2, 3, 4 et 5 , Georges Canguilhem.
- Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne.
- Le mur invisible de Marlen Haushofer, traduction de Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon.
En savoir plus sur les cours de français de prépa.
Introduction : Expériences de la nature, une confrontation aux limites du vivant
Le thème de français-philosophie pour les concours 2026 des classes préparatoires scientifiques (Centrale Supélec, Mines-Ponts, X-ENS, CCINP, etc.), « Expériences de la nature », propose une plongée réflexive dans un rapport fondamental et complexe : celui de l’être humain au monde naturel. Expérimenter la nature, ce n’est pas seulement la contempler ou l’habiter, c’est se confronter à ses lois, à ses rythmes, à ses mystères — et parfois à ses menaces.
Ce thème convoque des interrogations qui traversent la pensée occidentale depuis l’Antiquité : qu’est-ce que le vivant ? Peut-on connaître la nature sans la dominer ? Sommes-nous séparés de la nature ou pleinement inclus en elle ? Il s’agit aussi bien d’une exploration philosophique, scientifique, existentielle que littéraire de notre place dans le vivant.
À travers les trois œuvres au programme, La Connaissance de la vie de Georges Canguilhem, Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, et Le Mur invisible de Marlen Haushofer, c’est toute une diversité d’expériences du monde naturel qui se déploie : rigueur biologique et questionnement épistémologique chez Canguilhem, immersion technoscientifique et fascination des abysses chez Verne, survie introspective et rapport brut au vivant chez Haushofer.
La confrontation à la nature y prend des formes multiples : elle peut être solitude radicale, exploration méthodique, ou encore dialogue silencieux avec les animaux et les éléments. L’expérience devient alors transformation — de la perception, de la pensée, du rapport à soi — et permet de mettre en tension des oppositions classiques : nature/culture, corps/esprit, science/vie, langage/expérience.
En philosophie, des penseurs comme Merleau-Ponty ou Hans Jonas ont renouvelé la question du vivant, de l’organisme et de la responsabilité humaine face au monde naturel. En littérature, la nature est tantôt un refuge spirituel, tantôt un défi, tantôt un miroir de l’intériorité. Le thème de français en prépa scientifique 2025–2026 invite ainsi à interroger ce que signifie « faire l’expérience » d’un monde qui ne nous est ni tout à fait étranger, ni tout à fait familier.
L’étude de ce thème de prépa scientifique en philosophie vise non seulement à analyser des textes majeurs, mais aussi à construire une réflexion critique sur notre propre rapport au vivant : à l’heure des crises écologiques et du retour de la nature comme question politique, cette réflexion prend une résonance toute particulière. L’expérience de la nature devient alors une épreuve du réel et de la pensée, une occasion de redéfinir ce que signifie être vivant — parmi les vivants.
COURS PARTICULIERS FRANÇAIS EN CPGE
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs professeurs particuliers de français en Maths Sup et Spé
POUR ACCÉLÉRER MA PROGRESSION
Avis Google France ★★★★★ 4,8 sur 5
Œuvre 1 : La connaissance de la vie de Georges Canguilhem
La connaissance de la vie , « introduction : la pensée et le vivant, » « 1 méthode », « III philosophie »- chapitres 2, 3, 4 et 5 , Georges Canguilhem

Georges Canguilhem, né en 1904 a eu un parcours scolaire brillant en intégrant l’ENS puis en obtenant l’agrégation de philosophie en 1927. En 1941, il entreprend des études de médecine également. En s’engageant dans la résistance, il deviendra médecin. Il parvient tout de même en 1943 à soutenir une thèse de médecine. Il a développé une vision critique de la médecine et de la science qui a marqué de nombreux penseurs, dont Michel Foucault.
Ecrit en 1952, la connaissance de la vie examine des conceptions biologiques et médicales en insistant sur le fait que la vie ne peut pas se réduire à des concepts physico-chimiques. Pour Canguilhem, l’être humain est avant tout un être capable de création et d’autonomie.
Retrouvez l’analyse et le résumé sur la connaissance de la vie de Georges Canguilhem en CPGE
Œuvre 2 : Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne
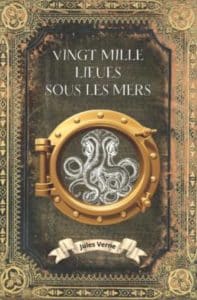
Jules Verne est un auteur français pionnier dans la science fiction et l’aventure. Né en 1828 dans une famille aisée. Il fait des études de droit et se trouve une passion pour le théatre et l’écriture.
L’ouvrage Vingt mille lieux sous les mers, fait partie d’une série intitulée « voyages extraordinaires » où Jules Verne va à la découverte des progrès scientifiques et les découvertes de son époque. Son œuvre a certainement influencé les inventions de la fusée, du sous marin ou encore des voyages dans l’espace.
Vingt mille lieux sous les mers, rédigé en 1870, est un livre de science fiction et d’aventure. Le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land partent à la recherche d’un monstre marin. Capturés après une attaque, ils découvrent qu’il s’agit du Nautilus, un sous-marin révolutionnaire commandé par le capitaine Nemo. Au cours du voyage, les trois aventuriers explorent les fonds de la mer et croisent des créatures inconnues. Némo refuse toutefois de libérer les passagers qui devront passer par de nombreuses péripéties pour s’échapper.
Lire aussi : Résumé de « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne
Œuvre 3 : Le mur invisible de Marlen Haushofer
Le mur invisible de Marlen Haushofer, traduction de Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon
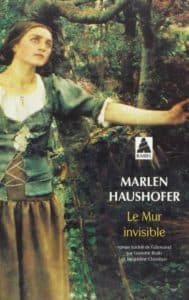
Marlen Haushofer est une écrivaine autrichienne née en 1920. Venant d’un milieu rural, elle étudie la littérature allemande à Vienne et à Graz. Ses premiers ouvrages datent des années 1950 avec des thèmes comme le féminisme, l’isolement ou encore l’oppression. Elle meurt d’un cancer en 1970 sans être réellement reconnue pour son œuvre de son vivant.
Le mur invisible est un roman introspectif écrit à la première personne du singulier. La femme qui raconte l’histoire découvre lors d’un séjour à la montagne qu’il existe un mur invisible, mais impossible à franchir, qui l’isole du reste du monde. Livrée à elle même et en compagnie que de quelques animaux, elle doit apprendre à survivre seule dans la nature. Le roman explore beaucoup de thématiques comme l’isolement, la relation de l’homme à la nature, la résilience et questionne les normes et les codes de la société moderne.
Résumé et analyse de Le mur invisible de Marlen Haushofer en CPGE
Première analyse sur le thème expériences de la nature
« Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n’as plus besoin de l’expérience. » Cette phrase que l’on prête à Léonard de Vinci illustre toute l’ambivalence de notre relation à la nature : entre fascination et volonté de maîtrise, observation respectueuse et tentative de compréhension voire de domination.
La nature a longtemps été perçue comme un cosmos harmonieux, ordonné, voire fatal. En faire l’expérience était à la fois une obligation ou une malédiction. Longtemps, faire l’expérience de la nature, c’était donc y être plongé corps et âme, y être exposé sans filtre : à ses rythmes, à ses colères, à ses dons. La nature était un cosmos ordonné, souvent perçu comme implacable et immuable, parfois même redouté : on y trouvait sa place… ou on la subissait.
Mais la modernité a bouleversé ce lien. À mesure que la science progressait, que les techniques s’affinaient, l’humain a cru pouvoir mettre la nature à distance. Il l’a analysée, classée, domestiquée. Il en a fait un objet : un décor à contempler, une ressource à exploiter, un système à optimiser. Dès lors la nature se construit face à la culture, le donné au construit, le vivant à l’artifice. Comme si la nature pouvait être contenue dans une éprouvette, et notre expérience d’elle reléguée à une page de manuel. Comme si l’humain, en s’affranchissant de sa propre nature, pouvait s’affranchir à son tour de la nature comprise comme environnement.
Toutefois, peut-on vraiment vivre sans l’expérience de la nature ? Peut-on se croire à ce point détachés de ce dont nous sommes issus ? Sénèque le disait déjà : « Travailler contre le vœu de la nature est peine perdue. »
Aujourd’hui, face à l’urgence climatique, une autre conscience émerge. La nature n’est plus un ailleurs. Elle n’est pas ce que nous devons dominer, mais ce que nous devons retrouver. Ce que nous devons, surtout, ré-expérimenter. L’humain n’est pas à part, il est un être vivant parmi d’autres qui fait partie intégrante de la nature. Le terme de « vivant » tend d’ailleurs à supplanter celui de « nature », pour souligner cette continuité.
Faire l’expérience de la nature, ce n’est donc plus simplement contempler un paysage ou recueillir des données scientifiques. C’est éprouver ses limites ; c’est entrer à nouveau en relation avec ce qui vit, avec ce dont nous faisons partie. C’est éprouver, par les sens et par l’esprit, une réalité à la fois extérieure et intérieure. L’expérience de la nature devient alors une manière de retrouver du sens, de redéfinir notre place, non plus au-dessus ou contre, mais au sein du vivant. L’expérience de la nature devient alors un acte de reconnexion : un geste physique, sensoriel, mais aussi philosophique. Un retour à l’humilité.
Concepts philosophiques pour la dissertation sur expériences de la nature
Le vivant comme normativité – Canguilhem
Canguilhem affirme que le vivant n’est pas un simple objet d’étude : il crée ses propres normes. L’expérience de la nature ne peut être dissociée de la subjectivité du vivant lui-même. Ce concept permet de remettre en question la neutralité des sciences et d’opposer objectivation scientifique et expérience vécue du vivant.
La nature comme altérité – Haushofer
Dans Le Mur invisible, la nature impose ses lois, sans médiation humaine. La narratrice, isolée, fait l’expérience d’une nature étrangère mais essentielle, qui lui apprend à survivre autrement. L’œuvre interroge notre vulnérabilité, notre capacité d’adaptation et la coexistence avec le non-humain.
Technique et expérience – Verne
Avec Vingt mille lieues sous les mers, Verne montre que la technique (le Nautilus) permet d’explorer la nature mais en modifie l’expérience. L’œuvre met en tension maîtrise du vivant et admiration du mystère naturel, soulignant que la science, loin d’être neutre, transforme profondément notre rapport au monde.
Méthodologie et pistes de dissertation sur le thème de français en prépa 2025-2026
Pour réussir votre dissertation sur le thème « Expériences de la nature », il est essentiel de croiser les approches des trois œuvres au programme :
- Canguilhem pense le vivant à travers une lecture scientifique et critique de la biologie.
- Verne explore la nature via la technique, entre émerveillement et maîtrise.
- Haushofer vit une expérience existentielle et sensorielle de la nature, liée à la solitude et à la survie.
Articulez ces perspectives autour de trois grands axes :
- Scientifique avec Canguilhem (vie, normativité, épistémologie)
- Technologique et esthétique avec Verne (progrès, exploration, fascination)
- Existentialiste et écologique avec Haushofer (solitude, lien au vivant, dépouillement)
Appuyez votre réflexion sur des citations sur le thème expériences de la nature précises des œuvres et des références philosophiques complémentaires (Merleau-Ponty, Jonas, Arendt, Thoreau).
Exemples de sujets possibles sur le thème expériences de la nature :
- Toute expérience de la nature est-elle une épreuve ?
- Peut-on connaître la nature sans l’instrumentaliser ?
- La solitude est-elle nécessaire à une véritable expérience de la nature ?
- La nature nous révèle-t-elle ce que nous sommes, ou ce que nous ne sommes pas ?

